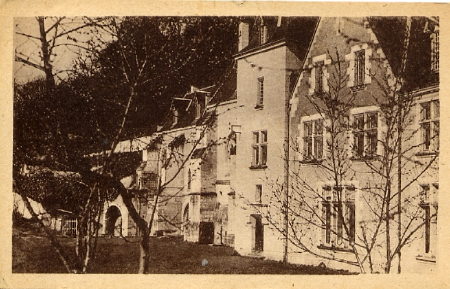La Volonnière.
(ou, selon les époques : Volloniere, Volonière et même Vaulonnière !)
 |
| La Volonnière – novembre 2008 |
HISTOIRE
Le 5 septembre 1551, Jean III de Chambray « rendit
aveu pour sa châtellenie de Poncé, à haut et
puissant prince Antoine De Bourbon duc de Vendômois, à
cause de sa baronnie de Lavardin. » Le fief de la Volonnière était l’un des vingt-et-un hommages de cette châtellenie.
Dans son ouvrage «Le Bas-Vendômois, de Montoire à la
Charte-sur-le-Loir », paru en 1894, L.A. HALLOPEAU précise
que « le fief de la
Volonnière … appartenait au 16e siècle
à Macé DUMANS ; son fils René DUMANS eut de son
mariage avec Marie DE SAINT MELOIR une fille, Anne, qui épousa
François TIRONNEAU. Au milieu du 17e siècle,
la terre de la Volonnière était passée à
Jean DU BUISSON, qui possédait aussi celles de la
Tendrière et de Paillard.
Dans la première moitié du 19e siècle,
le domaine de la Volonnière fut la propriété de
Julien QUETIN, fils de Julien QUETIN, l’associé
d’Elie SAVATIER. »
Emmanuel TOUBLET, curé de Poncé de 1879 à 1902,
dans son livre « La paroisse de Poncé »
imprimé à Mamers chez G.FLEUTY et A . DANGIN sur papier
de la Maison H. CHAUVIN de Poncé (aux Moulins de Paillard) et
publié en 1891, d’après son manuscrit «
Chroniques de Poncé », note, page 52, que « La Volonnière,
située à l’extrémité du bourg de
Poncé, du côté de La Chartre, a conservé une
partie de ses bâtiments du XVème siècle et une
porte qui se fermait par une herse. » Il ajoute : « des
constructions et des terrasses élevées par M.
QUETIN-POTHEE ont donné un caractère très original
à cet ancien fief. »
Dans son manuscrit, il est un peu plus précis : « (Mr
QUETIN-POTHEE) continua à diriger sa papeterie jusqu’en 1840,
époque à laquelle il cessa ses fonctions de maire. (Il)
prenait plaisir à embellir son parc de Bellevue
; il fit élever sur le sommet du coteau un espèce de
belvédère , construire les nombreuses terrasses qui
s’étagent depuis le bas de la colline jusqu’au haut.
Le manoir de la Volonnière
et la porte d’entrée reçurent une superposition de
constructions peu en rapport avec le style du vieux bâtiment mais
qui ont l’avantage de frapper vivement l’œil des
voyageurs … La vue du pavillon de Bellevue,
de la futaie qui l’entoure, des terrasses et des autres
constructions en est agréable à cause de
l’originalité qui a présidé à leur
arrangement. Le tout forme un parc très agréable et
très frais. Mr QUETIN avait élevé en avant des caves qui
existent sous le coteau un obélisque à la mémoire
d’Elie SAVATIER … »
Un peu plus loin, il ajoute : « Mr
Julien QUETIN mourut le 12 juin 1846 ; il avait cédé la
fabrique à ses fils et les fonctions de Maire à Mr
Alexandre QUETIN, le plus jeune. Sur la fin de sa vie, il ne
s’occupait plus que d’embellir son parc de Bellevue et de multiplier les constructions, qui donnèrent lieu au malin public de les qualifier de Folies Quetin.
» A noter que le nom de "Folies" est ici pris dans le sens usuel, du
fait de l’ambiguïté du mot qui a aussi une signification architecturale
: résidence de campagne, résidence d'été, très courante dans la région
nantaise où de nombreuses folies ont été construites par les armateurs
au 18e siècle. Le mot "folie" est dans ce cas une déformation de
"feuillée".
 |
Vue de l’obélisque et du belvédère.
|
Dans son livre, page 57, il ajoute, en 1891 donc :
« Dans le parc de la
Volonnière s’élève un obélisque avec
cette inscription, légitime hommage rendu à la
mémoire d’un homme de bien :
ELIE SAVATIER
FONDATEUR DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS
DE BESSE ET DE LA FABRIQUE DE PAPIER DE PONCE,
décédé le 9 juin 1785, âgé
de 68 ans.
JULIEN QUETIN, L’UN DE SES SUCCESSEURS,
A ELEVE CETTE COLONNE A LA MEMOIRE DE SON AÏEUL
le 30 juin 1841. »
Cet obélisque a sans doute été détruit dans
les années 1895-1900, car il n’existait plus en 1904, lors
de l’excursion organisée par la Société
historique et archéologique du Maine dans la vallée du
Loir, les 7 et 8 juillet 1904.
 |
Le Parc de la Volonnière en 1904.
|
EXCURSION HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DANS LA VALLÉE DU LOIR (7 ET 8 JUILLET I904).
Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine (Tome
56 – Année 1904 2ème semestre- pages 113 à
127 - texte intégral de la visite téléchargeable
ici (format pdf) et revue complète :
http://www.archive.org/details/revuehistoriquee56soci )
« L'excursion de la Société historique et
archéologique du Maine dans la vallée du Loir, le 7 et le
8 juillet, a si complètement réussi, cette fois encore,
et a laissé de si agréables souvenirs que nous ne pouvons
nous dispenser de lui consacrer, comme aux précédentes,
un rapide compte-rendu, ne serait-ce que pour remercier les excellents
collègues qui ont contribué à son succès.
(…)
A l'église, le maire, M. Chauvin, ingénieur des Arts et Manufactures,
notre confrère, et le curé, M. l'abbé Allier,
attendent la Société pour lui faire, avec le plus cordial
empressement, les honneurs du monument.
(…)
Au sortir de l'église, M. Chauvin, qui a revendiqué le
plaisir d'offrir à ses confrères une
généreuse hospitalité, s'empare de toute la troupe
pour l'emmener déjeuner dans son parc de la Volonnière.
Au passage, on traverse à pied le joli bourg de Poncé,
d'origine gallo-romaine ; on jette un regard sur l'antique fontaine de
Saint-Julien, souvenir traditionnel du séjour du premier
apôtre du Maine à la villa de Poncé ; puis on entre
quelques instants dans l'élégante habitation de M.
Chauvin, à la papeterie de Paillard.
Mme Chauvin, entourée de sa fille aînée et de Mlle
Marquet, veut bien y recevoir les hommages de ses hôtes, heureux
aussi de saluer dans ses salons un superbe portrait du XVIIIème
siècle et un remarquable buste d'Élie Savatier
l'éminent fondateur de tous les établissements
industriels de Bessé et de Poncé. Ce portrait, on s'en
souvient, a été publié par la Revue à
l'appui de la notice de M. l'abbé Toublet sur Élie
Savatier (1) ; le buste, tout récent, est l'oeuvre d'un artiste
vendômois de grand talent, M. Fernand Hamar.
Le soleil étant très ardent déjà et la
chaleur excessive, M. et Mme Chauvin ont eu l'excellente pensée
de choisir pour salle du déjeuner l'une des vastes caves qui s'ouvrent dans le coteau, sous les belles terrasses de la Volonnière.
Spacieuse, bien aérée et décorée de
feuillages, cette cave apparaît dans la circonstance comme un
délicieux oasis de fraîcheur et de repos.
Mme Chauvin et les deux charmantes jeunes filles qui lui servent
d'aides de camp font aux archéologues l'honneur de
présider le déjeuner.
Au dessert, M. Robert Triger se lève et prononce les paroles suivantes :
Mesdames, Messieurs,
A la différence de nos deux
dernières excursions à Fiesnay et au Mans, le petit
voyage de deux jours que nous
commençons ce matin sous de si agréables auspices ne doit
comporter aucun caractère officiel. C'est une réunion
tout intime d'amis, heureux toujours de se retrouver, heureux de
respirer en pleine et entière liberté l'air vivifiant de
la magnifique vallée du Loir, d'admirer ses sites splendides et
ses intéressants monuments.
Soyez donc sans craintes: ce n'est point un discours plus ou moins académique que je vais vous imposer en ce
moment, pas même une dissertation archéologique. Je dois
seulement, en quelques mots, traduire vos sentiments à tous, et,
suivant notre habitude d'honnêtes voyageurs, payer nos dettes.
Or, il y a quelques heures à
peine que nous sommes partis, et ces dettes sont déjà
bien grosses, non pour nos bourses, certes, mais pour notre gratitude.
Notre excellent confrère, M.
Chauvin, et Mme Chauvin nous ont ménagé dans ce
délicieux pays de Poncé l'une de ces réceptions
mémorables qui confondraient votre Président et nous
confondraient tous, Messieurs, si nous ne savions qu'elle est
dictée par la plus sincère et la plus gracieuse
cordialité. En vain, ai-je tenté de lutter contre la
générosité de cette hospitalité. Il m'a
fallu m'incliner et constater que notre Société
était une Société vraiment
privilégiée de posséder des amis comme M. Singher
et M. Chauvin, qui rivalisent d'une si aimable manière pour
exciter notre enthousiasme et réparer nos forces. Je ne puis,
Messieurs, que remercier chaleureusement M. et Mme Chauvin en votre nom
à tous et leur redire ici quel reconnaissant souvenir nous
garderons de leur réception.
Mais si la modestie de M. Chauvin ne
me permet pas d'insister davantage sur l'hospitalité qu'il a
bien voulu nous offrir, il est d'autres titres auxquels il nous
appartient tout entier et qui ne lui permettent pas de nous
échapper. Maire de Poncé depuis de longues années et membre de notre Société, M. Chauvin a secondé avec tant de dévouement M. l'abbé Toublet
dans sa belle découverte des fresques murales de
l'église, il a contribué si efficacement par ses
démarches et par son influence à la restauration de
l'édifice, qu'on peut dire que, dans son état actuel,
l’église de Poncé est devenue son oeuvre.
(…)
Enfin, Messieurs, comme ingénieur et directeur de la papeterie de Poncé, M. Chauvin continue dans le pays les nobles traditions industrielles de son éminent aïeul Élie Savatier.
Fondateur de tous les établissements industriels de Bessé
et de Poncé, Elie Savatier fut, au 18e
siècle, l'un des hommes les plus distingués et le grand
bienfaiteur de cette partie de la vallée du Loir. Vous le
connaissez d'ailleurs déjà, Messieurs, par
l'intéressante notice que M. l'abbé Toublet lui a
consacrée dans notre Revue en 1900. Caractère d'une rare
énergie, travailleur vaillant d'une haute intelligence, Elie
Savatier fut, comme l’a écrit très justement M.
Toublet, « l'un de ces hommes rares et précieux qui
vivifient les contrées où la Providence les a
placés ».
La Société historique
et archéologique du Maine est heureuse aujourd'hui de saluer la
mémoire de ce grand citoyen. Elle se proposait de déposer
un modeste hommage de sa gratitude sur la colonne commémorative
que M. Julien Quetin avait fait élever en 1841 à Elie Savatier, dans le parc de la Volonnière.
Cette colonne, endommagée par le temps, a été
depuis peu rasée et doit être remplacée
bientôt par un autre monument. En votre nom à tous,
Messieurs, je prie M. Chauvin de vouloir bien déposer sur ce
monument le petit souvenir que nous avions projeté de lui
ajouter nous-mêmes aujourd'hui.
Il témoignera des
fidèles sympathies que notre Société, soucieuse de
toutes les gloires du pays, conserve à Elie Savatier, à ses descendants et aux braves ouvriers papetiers, continuateurs de son oeuvre.
Nous ne saurions oublier, en effet,
Messieurs, que les ouvriers papetiers sont pour nous des auxiliaires
particulièrement utiles et précieux, car, sans papier,
nous serions fort embarrassés pour utiliser nos plumes. Je suis
donc assuré d'être votre interprète en adressant
non seulement au directeur mais à tout le personnel de la
Papeterie de Poncé notre cordial merci et nos amicales
félicitations.
(…)
Je me résume d'un mot, Messieurs, en levant mon verre avec une vive gratitude :
A M. et à Mme Chauvin !
A la commune de Poncé tout entière !
Aux amis absents !
A vous tous, Messieurs et chers collègues, nos fidèles et dévoués compagnons d'armes !
Au milieu d'applaudissements unanimes, M. Robert Triger remet alors
à Mme Chauvin le souvenir que la Société
historique et archéologique du Maine destine au monument
d'Élie Savatier, une palme artistique en bronze doré qui
porte sur le ruban d'attache cette inscription :
A ELIE SAVATIER
et à ses descendants,
La Société historique et archéologique du Maine,
7 juillet 1904.
M. Chauvin, tout ému,
répond par une très aimable improvisation. Il remercie
chaleureusement la Société de l'hommage si
spontané qu'elle vient de rendre au fondateur des
établissements industriels de Bessé et de Poncé.
Il rappelle en termes délicats la part prise par son Président à la découverte des fresques murales de
l'église, dont M. Robert Triger avait été le
premier à signaler l'importance dans un rapport au directeur
général des Beaux-Arts. Puis il invite ses
confrères présents à revenir plus tard assister
à l'inauguration du nouveau monument d'Élie Savatier, et
termine en portant un toast de sincère gratitude à la
Société historique et archéologique du Maine tout
entière.
Une triple salve d'applaudissements salue cette heureuse improvisation
du maire de Poncé et donne le signal du départ. Une
heure, en effet, vient de sonner : il est temps de remonter en
voitures. »
LA VOLONNIERE AU 20e SIECLE
Peu avant la première guerre mondiale,
la famille CHAUVIN, héritière des QUETIN et alors
propriétaire de la papeterie, fit construire sur la droite des
vieux bâtiments un nouveau bâtiment d’habitation dont
la toiture fut terminée au moment même où le tocsin
sonnait la déclaration de la guerre, le 3 août 1914.
 |
| La Volonnière en 1933. |
A la fin de la seconde guerre mondiale,
la Volonnière était devenue une colonie de vacances de
« La Jeanne-d’Arc de Ménilmontant », une
« œuvre d'éducation physique et morale de la
jeunesse » dans laquelle un certain Jacques Delors jouait au
basket !
LA VOLONNIERE EN 2008
Vue extérieure et intérieure des bâtiments du 15e siècle.
 |

Le porche du 14e siècle et le belvédère "Bellevue".
|
 |
 |
 |
Entrée des souterrains dans laquelle se trouve une pierre dédiée à
Madelaine Françoise POTHEE, épouse de Julien QUETIN (novembre 2008) |
Le château de la Volonnière a été
restauré en 1988 par Claude
Becquelin, et transformé en chambre d’hôtes.
Par Jean-Michel QUETIN - © Janvier 2009